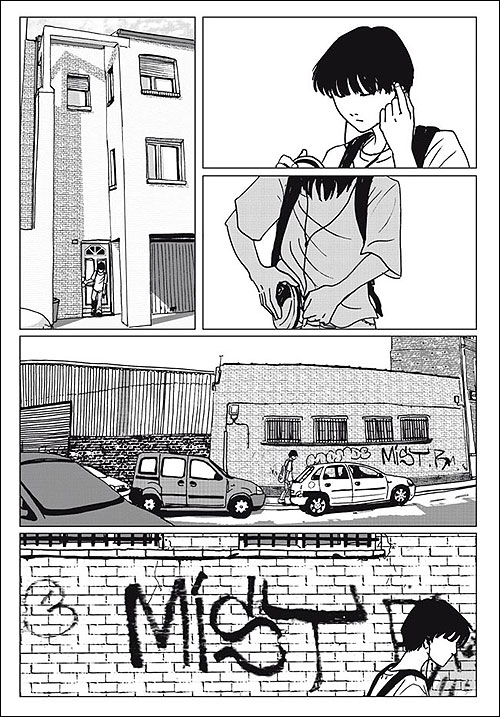Étiquetés dans le genre horrifique, ces deux titres même s'ils se développent dans les registres du gore et de l'horreur dépassent largement le cadre du récit à frissons, sans même tenter une entreprise de renouvellement du genre. Les critiques ont jusqu'à présent plutôt souligné le caractère excessif et démentiel de ses récits tout en soulignant l'esthétique propre à Hino - expressionnisme des visages et des corps torturés comme par l'enfer. Mais peu ont relevé derrière l'extravagance de ses mises en scènes le caractère grotesque voire burlesque de son œuvre ainsi que la profonde richesse de ses constructions narratives. Loin d'être un mangaka pervers ou dérangé, Hino s'avère être totalement maître de ses récits outranciers qui ont l'avantage de se prêter à de nombreuses lectures et relectures.
Avec Hino, l’horreur est présentée avec toutes les apparences d’un quotidien banal, c’est ce qui probablement lui donne autant de force. L’auteur n’emmène pas son lecteur d’une certaine réalité vers l’étrange ou le fantastique. Pas la moindre transition ni le plus petit glissement progressif du rationnel vers l’étrange n’est mis en place pour nous ménager : tout est livré d’emblée comme un univers horriblement normal. Son monde cauchemardesque s’impose brutalement au lecteur dès la première page : le surnaturel est le naturel, la folie le moteur du monde. Puis Hino procède par accumulation, exagération, surchargeant pour rendre compte d’un monde où les valeurs ne sont pas les mêmes que celles communément admises. Il montre un grand sens du rythme du récit, parvenant à imposer immédiatement une ambiance déroutante, un ton halluciné, des personnages qui en quelques cases dévoilent leur folie. Enfin le rythme s’emballe, les scènes s’enchaînent toujours plus sordides ou tordues que les précédentes, le narrateur communiquant son angoisse et ses obsessions au lecteur jusqu’à la mise en scène finale où l’hystérie atteint son point paroxystique. Hino orchestre véritablement cette montée en puissance, cette intensification des scènes horribles liées à l’exacerbation totale des tares de ses personnages.
Il ne faudra évidemment pas s’arrêter aux premiers ingrédients présents du gore : animaux décapités, métamorphoses hideuses des personnages, furoncles purulents, zombies sortant des cimetières, sang giclant en tout sens… qui sont convoqués pour leur aspect parodique mais qui prennent ici aussi un véritable sens, tout à fait particulier, qui va justifier leur présence.
On verra que l’humour noir et parodique joue aussi un rôle important, permettant d’atténuer le désespoir qui se dégage de ces récits. Hino ajoute à ces éléments de l’horreur traditionnel ceux du conte noir ou fantastique en utilisant ou en détournant des thèmes et des codes propres au conte : le fruit sanglant, l’enfant démoniaque, la beauté altérée….
Autre conseil : ne vous arrêtez pas non plus à la noirceur des personnages tous plus pervers et dégénérés les uns que les autres ! Pas de héros positif ni innocent chez Hino, et les enfants ne sont pas exempts de ce traitement (le jeune narrateur de Serpent rouge, même s’il subit beaucoup est aussi présenté comme un petit voyeur lâche qui provoquera la ruine de sa famille…) Les enfants dont on assiste aux naissances dans les deux récits ne sont en aucun cas une figure salvatrice ou innocente : non seulement ils provoquent la mort ou la folie de leur mère mais sont aussi des monstres difformes, dévorateurs de chair humaine ou vampires assoiffés de sang, annonciateurs d’ailleurs de malheurs plus grands encore.
 Les femmes sont particulièrement mises à mal : magnifiquement dessinées dans le plus pur style "Genji" hérité des estampes traditionnelles, avec des yeux très bridés, des visages épurés, sourcils hauts et courts, habillées souvent du traditionnel kimono, toutes de grâce orientale... elles se révèlent épouses folles, mères violentes, femmes perverses et Hino semble prendre un plaisir certain à les abîmer ou à les déformer monstrueusement. Rien d’autre derrière cette sublime beauté, tout n’est qu’apparence…
Les femmes sont particulièrement mises à mal : magnifiquement dessinées dans le plus pur style "Genji" hérité des estampes traditionnelles, avec des yeux très bridés, des visages épurés, sourcils hauts et courts, habillées souvent du traditionnel kimono, toutes de grâce orientale... elles se révèlent épouses folles, mères violentes, femmes perverses et Hino semble prendre un plaisir certain à les abîmer ou à les déformer monstrueusement. Rien d’autre derrière cette sublime beauté, tout n’est qu’apparence…
 La culpabilité, la malédiction, les destins tragiques sont des thèmes communs aux deux récits : les personnages ne peuvent échapper à leur destin, ils héritent d’un passé familial, physique, historique dont ils ne peuvent s’affranchir et qui les condamnent à errer et à souffrir… Le sang, la métamorphose, la pourriture, la destruction physique (décapitation, membres arrachés ou tranchés, cheveux tombants ou arrachés, automutilations…) sont aussi des motifs récurrents mais qui ne composent pas les ressorts de l’action, ils sont là comme quelque chose de naturel et d’admis dans ce monde qui fonctionne avec une logique cauchemardesque…
La culpabilité, la malédiction, les destins tragiques sont des thèmes communs aux deux récits : les personnages ne peuvent échapper à leur destin, ils héritent d’un passé familial, physique, historique dont ils ne peuvent s’affranchir et qui les condamnent à errer et à souffrir… Le sang, la métamorphose, la pourriture, la destruction physique (décapitation, membres arrachés ou tranchés, cheveux tombants ou arrachés, automutilations…) sont aussi des motifs récurrents mais qui ne composent pas les ressorts de l’action, ils sont là comme quelque chose de naturel et d’admis dans ce monde qui fonctionne avec une logique cauchemardesque… Peignant ses toiles avec son propre sang, un peintre hystérique nous convie à devenir les spectateurs de son projet artistique : peindre le tableau de la fin du monde. Mais avant la réalisation de ce chef d’œuvre ultime déjà en cours, il nous invite à découvrir douze tableaux, préludes à l’horreur finale qui s’offriront comme les paliers d’une descente progressive et lancinante aux enfers, un voyage dans l’univers de la folie humaine.
Peignant ses toiles avec son propre sang, un peintre hystérique nous convie à devenir les spectateurs de son projet artistique : peindre le tableau de la fin du monde. Mais avant la réalisation de ce chef d’œuvre ultime déjà en cours, il nous invite à découvrir douze tableaux, préludes à l’horreur finale qui s’offriront comme les paliers d’une descente progressive et lancinante aux enfers, un voyage dans l’univers de la folie humaine. Cette plongée dans l’histoire personnelle du narrateur, sous forme de flashes backs et de digressions, d’où l’humour n’est d’ailleurs pas absent, met en avant le destin brutal et funeste de cette famille : le tatouage dorsal hérité de père en fils serait le signe de cette malédiction.
Cette plongée dans l’histoire personnelle du narrateur, sous forme de flashes backs et de digressions, d’où l’humour n’est d’ailleurs pas absent, met en avant le destin brutal et funeste de cette famille : le tatouage dorsal hérité de père en fils serait le signe de cette malédiction. Le père du narrateur en fuyant avec son épouse en Mandchourie, tente d’échapper à cette spirale maudite mais son envie de se libérer sera brisée par la guerre : démonstration magistrale de la vanité de vouloir échapper à son sort, fixé par le destin et le pays auquel on appartient. Et enfin, le narrateur éclairera les conditions de sa naissance et de son attrait pour la destruction : sa mère touchée par un éclair dû à l’explosion atomique d’Hiroshima tombe enceinte et le met au monde : enfant défiguré, nourrisson vampire se régalant de sang, il est perçu littéralement comme le fils de la bombe et donc du démon de l’enfer ! Forcée de quitter la Chine en plein hiver pour le Japon, la famille fait partie de l’exode des colons de Mandchourie marquée par les suicides collectifs, les assassinats et les bombardements chinois… Cette séquence semble être en fait le récit sublimé des premières années d’Hino lui même. (Les parents japonais d’Hideshi Hino installés en Mandchourie devront fuir peu après sa naissance en 1946 dans des conditions difficiles qui mettront en péril la survie de l’enfant. Hino découvrira ensuite le Japon encore sous le choc de l’apocalypse nucléaire).
Le père du narrateur en fuyant avec son épouse en Mandchourie, tente d’échapper à cette spirale maudite mais son envie de se libérer sera brisée par la guerre : démonstration magistrale de la vanité de vouloir échapper à son sort, fixé par le destin et le pays auquel on appartient. Et enfin, le narrateur éclairera les conditions de sa naissance et de son attrait pour la destruction : sa mère touchée par un éclair dû à l’explosion atomique d’Hiroshima tombe enceinte et le met au monde : enfant défiguré, nourrisson vampire se régalant de sang, il est perçu littéralement comme le fils de la bombe et donc du démon de l’enfer ! Forcée de quitter la Chine en plein hiver pour le Japon, la famille fait partie de l’exode des colons de Mandchourie marquée par les suicides collectifs, les assassinats et les bombardements chinois… Cette séquence semble être en fait le récit sublimé des premières années d’Hino lui même. (Les parents japonais d’Hideshi Hino installés en Mandchourie devront fuir peu après sa naissance en 1946 dans des conditions difficiles qui mettront en péril la survie de l’enfant. Hino découvrira ensuite le Japon encore sous le choc de l’apocalypse nucléaire). Hanté par la figure du champignon atomique, le narrateur en sculpte une effigie et lui voue un véritable culte. La statue du champignon atomique, aspergé de sang s’avère magique et va lui permettre de réaliser tous ses fantasmes de destructions planétaires, concrétisant ainsi l’œuvre de sa vie : être l’auteur de la fin du monde… sous forme d’une représentation en image ou réellement, grâce au pouvoir nucléaire ? Dans un final hallucinant, le peintre massacre tous les membres de sa famille (dont on s’aperçoit qu’ils sont en fait des marionnettes, un automate, un animal) et se retrouve, après avoir brisé les murs de sa maison (raison ?) face à une mer de sang d’où, tout en nous hurlant son immortalité, nous prophétise la fin du monde, en nous jetant à la face une hache ensanglantée !
Hanté par la figure du champignon atomique, le narrateur en sculpte une effigie et lui voue un véritable culte. La statue du champignon atomique, aspergé de sang s’avère magique et va lui permettre de réaliser tous ses fantasmes de destructions planétaires, concrétisant ainsi l’œuvre de sa vie : être l’auteur de la fin du monde… sous forme d’une représentation en image ou réellement, grâce au pouvoir nucléaire ? Dans un final hallucinant, le peintre massacre tous les membres de sa famille (dont on s’aperçoit qu’ils sont en fait des marionnettes, un automate, un animal) et se retrouve, après avoir brisé les murs de sa maison (raison ?) face à une mer de sang d’où, tout en nous hurlant son immortalité, nous prophétise la fin du monde, en nous jetant à la face une hache ensanglantée !Le récit est extrêmement bien construit, avec une montée en puissance dans l’horreur d’autant plus qu’elle devient réelle, renvoyant à des évènements ou des images historiques. L’humour noir et l’exagération cèdent vite le pas à une réelle tension, une ambiance pesante menant le lecteur loin des sentiers battus de ce genre fictionnel qu’est l’horreur en bande dessinée. L’enchaînement des scènes est rapide et fluide, aucun élément ne s’avère mentionné par hasard, chaque scène trouvant son sens tout en éclairant les autres au fur et à mesure où nous progressons dans le récit. Le dessin expressionniste qui exagère les noirs et les ombres en jouant beaucoup du silhouettage, rappelant judicieusement le théâtre d’ombres (les personnages ici ne seraient-ils pas des marionnettes, soumis au destin ?)
Sur la page de titre, le narrateur, avec un sourire béat, arrache sa peau et écarte sa boite crânienne pour en laisser échapper des figures hurlantes et en cours de décomposition.
Ces visages représentent-ils les visions d’horreur nées de l’imaginaire d’un personnage dérangé ? Ne sont-ils que les représentations mentales d’un fou se construisant un monde et une famille de fou ? Ne seraient-ils pas plutôt les représentations et les images du réel, renvoyant au passé et aux souvenirs et donnant bien du sens à la folie de cet homme ?
La lecture d’Hino pourrait relever plus de l’épreuve que du plaisir, et la dernière altercation du narrateur interpellant le lecteur, lui ordonnant de mourir, lui jetant sa hache à la figure, peut accentuer cette impression de malaise.
 Pourtant ce récit malgré sa dimension tragique d’évocation et d’évacuation du traumatisme d’Hiroshima, développe une dimension humoristique, celle d’un récit grand guignolesque, casi parodique : la scène où un zombie déguste un carpaccio de fesses est assez hilarante (les zombies mangeant à l’auberge des parties de leur propre corps qui repoussent d’ailleurs le lendemain).
Pourtant ce récit malgré sa dimension tragique d’évocation et d’évacuation du traumatisme d’Hiroshima, développe une dimension humoristique, celle d’un récit grand guignolesque, casi parodique : la scène où un zombie déguste un carpaccio de fesses est assez hilarante (les zombies mangeant à l’auberge des parties de leur propre corps qui repoussent d’ailleurs le lendemain). Cet humour n’est pas sans rappeler le ton de la série et du film la Famille Adams et le dessin exagérément disproportionné rajoute une connotation comique voire burlesque à ce récit. Une autre dimension apparenterait également ce récit au conte noir fantastique. Les symboles, les références, les jeux de mots et les images sont en effet nombreux à décrypter : le leitmotiv de la tête coupée, symbole de la perte de la raison des hommes, ou le tatouage des hommes, marquage d’un destin programmé en sont quelques exemples.
Cet humour n’est pas sans rappeler le ton de la série et du film la Famille Adams et le dessin exagérément disproportionné rajoute une connotation comique voire burlesque à ce récit. Une autre dimension apparenterait également ce récit au conte noir fantastique. Les symboles, les références, les jeux de mots et les images sont en effet nombreux à décrypter : le leitmotiv de la tête coupée, symbole de la perte de la raison des hommes, ou le tatouage des hommes, marquage d’un destin programmé en sont quelques exemples.Certaines scènes font écho à des références cinématographiques, littéraires voire même bibliques. Au dernier chapitre, avant de briser les murs de sa maison-prison, le peintre mange avec délectation les fruits diaboliques poussés grâce au sang des têtes des guillotinés (présentés dans le premier chapitre, têtes déportées dans des wagons…) : le fruit symbole de l’accès à la Connaissance ouvre ici sur le monde de la folie et de la mort programmée.
On le voit cette vision cauchemardesque sur la guerre, ses atrocités, le goût de l’homme pour la violence, la torture, la mort infligée, institutionnalisée à grande échelle ou accomplie dans l’intimité de la maison, et ce monde post atomique est loin d’être un simple délire gratuit de catalogue de situations horrifiques, titillant le voyeurisme du lecteur, comme quelques critiques se sont contentés de voir, non, cet album apparaît bien comme la retranscription esthétique par Hino de l’absurdité de notre monde, du mal engendré par l’homme. « Ce monde est un enfer » dit le père du peintre. Que fait donc notre peintre/narrateur et son double Hino ? Il nous le montre ce monde, le dépeint, le commente, nous le jette à la figure dans toute sa monstruosité et nous embrouille à souhait, introduisant des forces supérieures et surnaturelles, parfois plus à même de donner un sens à l’absurde que la raison… La seule issue qui semble proposée par notre auteur, ce sera donc la folie ou son alternative, l’art…
Une lecture historique de l'album ne pourrait manquer de relever les moments cruciaux de l'histoire japonaise présentés ici : le bombardement d'Hiroshima mais aussi l'évacuation de la population japonaise ayant colonisé la Chine et la Corée ainsi que les exactions commises par l'armée japonaise sur ces peuples.
Les premières pages de l'album, si elles ne manquent pas de rappeler le génocide organisé par les nazis, pourraient bien évoquer cette entreprise de tortures et d'assassinats de milliers de coréens et chinois par l'armée japonaise (Rappelons quelques crimes commis par l’armée impériale : l’Unité 731, une unité de l’armée japonaise qui se livra à des expériences de guerre bactériologique et à des vivisections sur 3000 personnes, pour la plupart des civils chinois ; les Massacres de Nankin : de 150 000 à 300 000 civils chinois exécutés dans des conditions atroces lors de l’invasion de la Chine du Nord en 1937; le travail forcé des prisonniers de guerre…)
La famille du narrateur de Panorama de l'enfer complètement folle au sein d'un monde démembré et torturé pourrait être interprétée comme une allégorie de la société japonaise ou plutôt de la conscience collective japonaise. En effet, le gouvernement japonais minimise encore aujourd'hui ces massacres et refuse de reconnaître les exactions commises à l'encontre des peuples coréen et chinois. La conscience collective japonaise serait confrontée à ce refus d'envisager donc de dépasser cette facette de sa propre histoire. Parallèlement le traumatisme des deux explosions nucléaires est bien présent chez Hino, plongeant les personnages dans une attitude schizophrénique : sont-ils des bourreaux ou des martyrs ?
Le personnage principal de Panorama de l’enfer souffre de troubles qui s’apparentent à la schizophrénie : automutilation, démembrement, etc. Ici, l’hypothèse de la famille représentant la mémoire collective japonaise prendrait tout son sens.
Hideshi Hino semble tirer le signal d’alarme avec cet album, notamment avec cette dernière vignette qui avertit le lecteur d’un futur déferlement de violence. Le Japon, société en proie aux contradictions, ne pourrait aller de l'avant qu'en faisant une analyse rétrospective de son comportement pendant la seconde guerre mondiale, si elle veut éviter certains troubles… familiaux…?
Le serpent rouge

Construit comme un conte, avec un décor initial posé – une lugubre demeure perdue dans une vaste forêt infranchissable- un héros, jeune narrateur aux yeux exorbités empli d’angoisse qui donne le ton, et le ressort dramatique -la mise en garde terrible du grand-père : ne jamais s’approcher du miroir bloquant un couloir, derrière lequel se trouverait un labyrinthe maudit peuplé de démons et la chambre close qui doit bien évidemment ne jamais être ouverte…
(Pour un peu, on retrouverait du Harry Potter chez Hino ! enfin, le ton et l’ambiance rappelleraient beaucoup plus Barbe Bleue…) Seul l’enfant semble ressentir une certaine inquiétude dans ce monde un peu étrange. Et pour cause ! La présentation de sa famille va nous permettre de comprendre sa frayeur et justifier ses tentatives infructueuses hélàs de fuite : la grand-mère se prend pour une poule, vit dans un nid énorme en couvant consciencieusement les oeufs que son fils lui ramène de son élevage, celui ci prend un certain plaisir à élever des vers et à décapiter les poules qui ne pondent plus pour ensuite pendre leurs têtes au beau milieu du pondoir.

Pendant ce temps, le grand-père entretient un écœurant rituel avec sa belle-fille (qui consiste à devoir lui masser un énorme furoncle qu’il a au cou avec une crème d’œuf) tandis que l'aînée des enfants s'amuse à jouer avec les vers (qu’elle mange ensuite) si durement entretenus par son paternel…On comprend donc que notre narrateur ne chercher qu’à quitter cette famille dont il est condamné à observer les rituels écoeurants ! Mais l’interdiction formelle du grand père tout en terrifiant encore plus l’enfant, excite évidemment sa curiosité. Et c’est au cours d’un rêve que l’enfant va traverser le miroir et ouvrir la Chambre close, libérant le serpent rouge, le messager du malheur… (Il est probable que certains éléments gagneraient à être éclairés par une connaissance accrue de la culture japonaise: nous savons que le monde des rêves joue un grand rôle dans les contes du folklore asiatique où ils sont des portes pour accéder au domaine des fantômes... Se nourrissant des rêves humains, le démon Baku est aussi représenté ainsi que la femme serpent, née d'un caricatural conte érotisant japonais issu des Konjaku Monogatari)
A partir de là, le semblant d’harmonie qui régnait entre eux -la folie des uns s’accordant à celle des autres- est brisé : les travers et la folie de chaque personnages va se déchaîner, et le récit va aller rapido-crescendo jusqu’à l’hystérie finale, un espèce de jeu de massacre collectif d’où notre malheureux narrateur tente d’échapper... Le thème de la métamorphose est habilement mis en scène : tous les personnages vont subir une transformation physique qui va engendrer comme dans une réaction en chaîne la violence finale qui conserve malgré tout un aspect comique, né de cette exagération outrancière (le serpent vampirise la sœur qui tue les poules pour s’abreuver de leur sang, déclenchant la colère du grand père. Au cours d’une violente dispute, elle lui tranche un pied, le furoncle déplacé du cou à la cheville tranchée du grand père explose, brûlant et déformant le visage de la belle fille qui ainsi ensemencée donne naissance à un enfant difforme qui déchire le ventre maternel en venant au monde et dévore la grand mère entre temps devenue une poule géante ! ! !)
Echappant à la boucherie générale, l’enfant poursuivi par le serpent rouge par lequel il sera finalement piqué va traverser le miroir, naviguer sur une mer de sang (comme dans l’autre récit d’Hino, les têtes des morts flottent sur cette mer de sang, ) qui s’avérera pleine de dangers… L’enfant se réveillera devant un miroir intact, sans savoir si c’était un cauchemar ou si le miroir lui a permis d’entrevoir autre chose, ce monde de l’autre côté. Il retrouve sa famille telle qu’elle se présentait au début, avec sa petite folie arrangée et dont tous sont accommodés. Le récit se ferme sur lui même et ne propose que sa relecture, éternellement.
Le récit est construit autour de la notion d’interdit et déviance. Il y a d’abord l’interdiction de passer à travers le miroir et d’explorer un monde autre, perçu comme maudit. Et il y a aussi cet interdit de l’inceste poussé ici sans ses limites au travers des relations quasi incestueuses qu’entretiennent les personnages. Les pulsions s’avèrent plus fortes que tous les interdits et les pulvériseront. C’est dans son rêve que, poussé par le désir de savoir, l’enfant va passer au travers du miroir et découvrir autre chose qui s’avère finalement être pire. Ce monde qui tourne sur lui-même comme une spirale infernale et sans fin ne serait-il pas une représentation de la folie de ce jeune garçon qui aurait donc inventé complètement ce récit ? ou alors ce n’est effectivement que la seconde partie qui est rêvée: le miroir ne renvoyant l’enfant qu’à lui même, qu’à sa propre image et à ses désirs permettrait cette interprétation. Mais le monde extérieur ou une autre vie symbolisée par la chambre close semble alors pire que l’initiale, déjà bien inquiétante…
On le voit, les récits de Hino ne se laissent pas facilement décrypter et sont plus complexes qu’ils n’y paraissent. Loin du simple gore (dont le sens littéral en anglais est « sang séché »), ces récits proposent de nombreuses lectures qui renvoient sans cesse à la nature profonde de l’homme.
L’éditeur nous prévient que ces deux œuvres qu’il présente d’Hino sont réservées à un « public averti »… en espérant que vous le soyez un peu mieux à présent… (Signalons au passage la belle qualité de ces livres : papier de qualité, couverture souple en couleurs, onomatopées conservées en langue originale qui montrent ici tout leur intérêt graphique et narratif…)
L'éditeur
IMHO (In My Humble Opinion… non ce n’est pas un canular !) s’est lancé dans l’aventure éditoriale en septembre 2003 en publiant quelques mangas dont les auteurs étaient inconnus en France et qui présentent l’avantage de nous faire découvrir un pan atypique de la production japonaise. C’est Junko Mizuno qui a ouvert le catalogue avec Cindarella (au départ illustratrice, Mizuno a adapté trois contes européens dans un style avec des couleurs très relevéés), puis Hideshi Hino et Suehiro Maruo, qui ont en commun d’être classés dans le genre bande dessinée d’horreur. Mais l’éditeur affirme ne vouloir ni se spécialiser dans ce genre particulier ni même limiter son activité éditoriale au manga. En effet, des projets liés à la littérature et la musique montrent une volonté d’organiser et de développer des rencontres entre plusieurs champs artistiques différents.
Pour en savoir plus sur Hino
Sa première histoire, Sueur froide, paraît en octobre 1967 dans Com,le magazine de manga adulte créé par TEZUKA. Il entame par la suite une série de récits horrifiques qui compte à l'heure actuelle une quinzaine de volumes, dont Hell baby et Panorama of Hell, publiés en anglais par Blast Books. On a également pu découvrir HINO en Occident grâce à Comics Underground Japan, du même éditeur, anthologie contenant un récit du mangaka : Laughing ball.
Une autre anthologie, française cette fois-ci, incluait un récit de HINO ; il s'agissait du Comix 2000, énorme volume publié par L'Association, maison phare de l'édition alternative en France, à l'occasion de l'an 2000. HINO faisait partie des rares mangaka qui y avaient apporté leur contribution (avec HANAWA Kazuichi notamment), pour un récit des plus marquants : Blood fruit, où il se livrait à une revisitation du conte de Blanche Neige qui tournait au cauchemar. Serpent rouge est sorti au milieu des années 80 au Japon sous le titre d'Akai Hebi, tout comme le premier volet de la série des Guinea Pig, films d'horreur dérangeants qu'’Hino a réalisés pour la plupart, et considérés comme cultes aux yeux des adorateurs du genre. Hino a été nominé au Salon International de la bande dessinée d’Angoulême 2005.
Article paru dans Intercdi, N°195 ; juin 2005